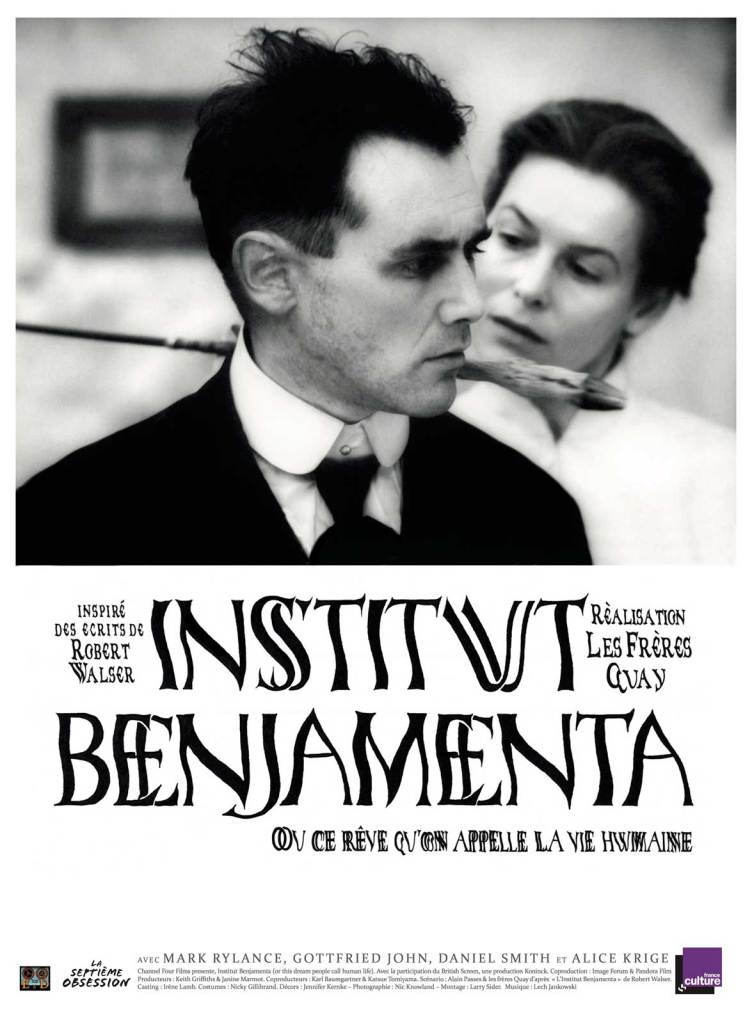Après un début en fanfare, dans lequel je retrouvais Mon Enrique Vila-Matas, celui que j’aime tant, avec son personnage principal favori, Madame la Littérature, me disant que je lisais peut-être son meilleur livre, l’avant-dernier qu’il ait publié, le dernier pour les éditions Bourgois (pourquoi diable l’animal a-t-il changé de boutique ? la question me tarabuste…), j’ai finalement déchanté et je m’apprête donc à chroniquer Mac et son Contretemps pour, une fois n’est pas coutume, le descendre en flèche !
Mac tient son prénom de l’amour de ses parents pour un film de John Ford, My Darling Clementine, dans lequel un des personnages s’appelle ainsi. Ancien entrepreneur qui a fait faillite, il ne travaille plus et en profite, lecteur insatiable pour remettre le nez dans ses auteurs favoris (il a une connaissance assez pointue, quoique parfois douteuse, de la littérature qui en fait une sorte d’alter ego fictif de l’auteur catalan, mais il ne faut pas s’y tromper…) et se mettre à l’écriture, en tant que débutant. Projet : écrire un faux roman posthume et inachevé par la cause de la mort de son auteur, petit rappel si besoin en était que l’imposture est au cœur des thématiques favorites de Matas. Mac est le voisin d’un écrivain qu’il entend un jour pérorer devant une belle libraire du quartier sur l’un de ses premiers livres, un recueil de nouvelles truffé de passages lourdauds et ennuyeux de son propre dire, que Mac a bien sûr lu sans aller jusqu’à son excipit et qu’il entreprend de relire dans le but de le réécrire en répétant, mais surtout en l’améliorant, en le modifiant. Mac se veut modificateur. Il y a de la mise en abime dans l’air : Vila-Matas, qui écrit inlassablement le même livre en le modifiant, fait avec lui-même et ses propres livres le travail auquel Mac se prépare avec le bouquin de son voisin… Mais ce coup-ci, il me semble qu’Enrique Vila-Matas en se répétant finit par se caricaturer !
Le texte qu’on lit est censé être le journal de Mac. Et au début, tout va bien : Mac évoque ses auteurs favoris, expose ses intentions, raconte aussi sa vie conjugale et ses promenades dans le quartier el Coyote de Barcelone, ses rencontres avec le neveu de Walter, le voisin écrivain. Un faux neveu, Walter n’ayant pas de neveux… Et puis, progressivement, le journal de Mac accumule les passages lourdauds et ennuyeux, comme le recueil de jeunesse de Walter, et il commence à faire le récit des nouvelles du livre qu’il veut reprendre, et insensiblement, le bouquin s’enlise dans un fatras de plus en plus imbuvable. La dernière moitié du roman de 400 pages est assez insoutenable et le côté très intellectuel des réflexions du narrateur, mais aussi sa folie banale, ou sa névrose finissent par lasser, tout autant que le récit des nouvelles, les unes après les autres, et le doublement, la répétition, nouvelle après nouvelle, de ce recueil avec les intentions de révision du texte par Mac. La composition du livre devient par moment assez confuse, le discours peu excitant, la répétition dans la répétition assommante. Dublinesca, lu l’an dernier lors de sa parution en poche, ne m’avait pas paru être du meilleur Vila-Matas, rétrospectivement sa valeur s’en trouve rehaussée par la lecture de Mac et son contretemps, que je n’ai pas trouvée stimulante, comme c’est généralement le cas avec les romans-essais de cet écrivain. Ce verdict, lancé sans chercher à le justifier en détail par absence d’envie de m’éterniser sur une cogitation vaine à propos d’un livre que j’ai mis beaucoup de temps à lire dès lors qu’il m’est apparu très ennuyeux, n’engage évidemment que moi, et des lecteurs que la réflexion sur l’acte d’écrire proposée par ce roman intéressera auront un avis autre que le mien et crieront peut-être au chef-d’œuvre. C’est tout le bien que je leur souhaite et que je souhaite à mon écrivain espagnol favori, ainsi qu’à son roman.